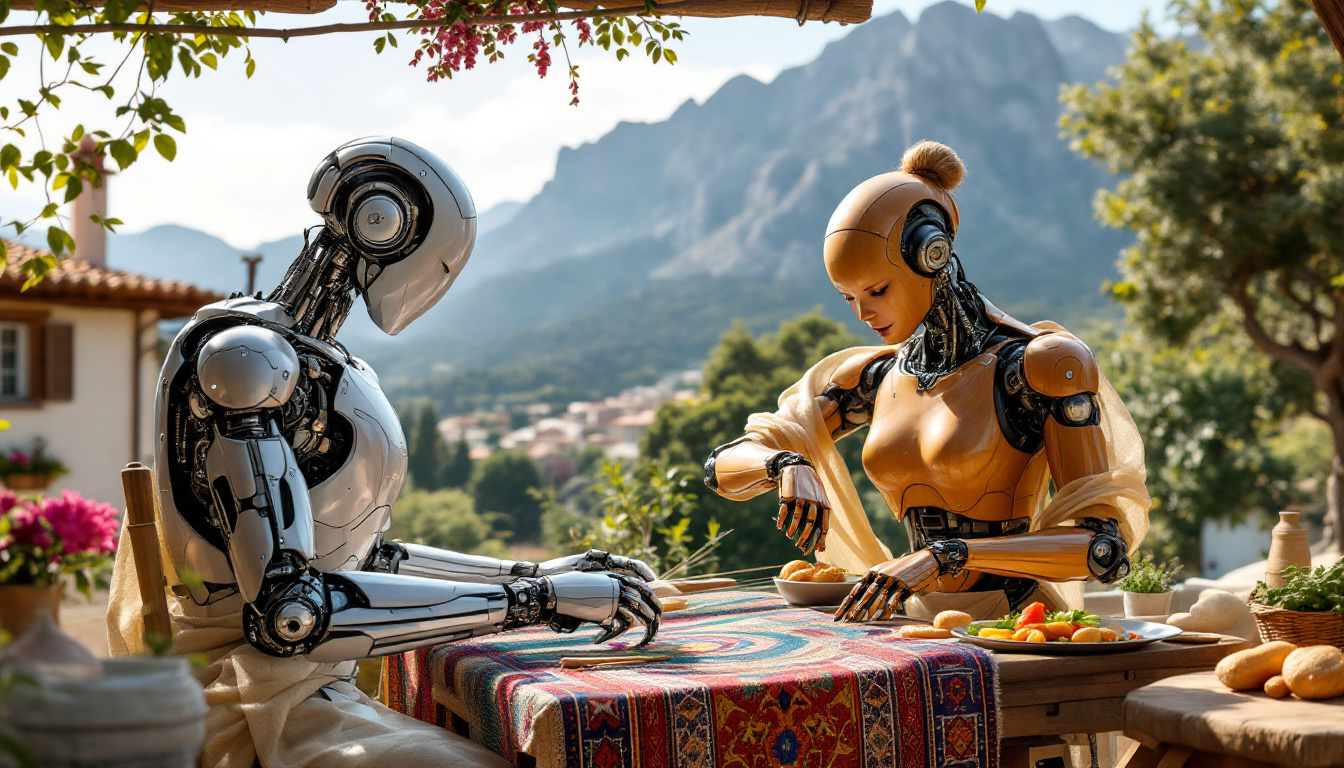|
EN BREF
|

L’intelligence artificielle et le Bitcoin sont souvent pointés du doigt pour leur consommation d’énergie. Bien qu’ils soient tous deux des moteurs d’innovation numérique, leurs impacts énergétiques sont distincts. Cet article examine les données récentes pour comprendre leurs consommations respectives et leurs implications pour notre avenir énergétique.
Sommaire
ToggleL’intelligence artificielle : un consommateur majeur avec des perspectives de croissance
La montée en puissance de l’intelligence artificielle est intrinsèquement liée à la demande croissante d’énergie. Les centres de données dédiés à l’IA nécessitent une alimentation électrique continue pour traiter de vastes quantités de données. Selon une étude de Selectra, la consommation d’électricité de ces infrastructures pourrait atteindre environ 945 TWh d’ici 2030, un chiffre équivalent à la demande annuelle du Japon.
Cette demande énergétique s’explique principalement par l’essor de l’IA générative, qui requiert des capacités de calcul avancées pour les modèles linguistiques, le traitement d’image et l’optimisation industrielle. De plus, les pays producteurs d’électricité, tels que la France, voient une opportunité dans cette tendance. EDF, par exemple, a récemment lancé des initiatives pour implanter des centres de données près de ses centrales nucléaires et hydrauliques, promouvant une consommation locale bas-carbone.
Bitcoin : une consommation identifiable et limitée
Le Bitcoin, quant à lui, repose sur un protocole de validation décentralisé qui nécessite une puissance de calcul continue. En 2025, sa consommation électrique est estimée à environ 188 TWh par an, représentant environ 0,7 % de la consommation mondiale. Contrairement à l’IA, l’usage du Bitcoin est moins répandu dans différents secteurs économiques, étant principalement concentré dans des fermes de minage.
Ces installations sont généralement situées dans des régions où l’énergie est à la fois abondante et peu coûteuse. Certains pays, comme le Pakistan, ont ainsi intégré l’exploitation de la cryptomonnaie dans leur politique énergétique, réaffectant les surplus de production électrique à ces usages spécifiques. Cette prévisibilité de la consommation permet d’envisager une intégration stratégique du Bitcoin dans les réseaux électriques, en particulier pour soutenir les énergies renouvelables intermittentes.
Le rôle de l’intelligence artificielle dans l’optimisation énergétique
En plus de sa propre consommation d’énergie, l’intelligence artificielle joue un rôle crucial dans l’optimisation des systèmes énergétiques. Elle permet d’ajuster la charge, d’anticiper les pics de demande et de gérer la maintenance prédictive, renforçant ainsi la résilience des réseaux énergétiques face aux aléas climatiques. Ces fonctionnalités sont déjà en cours d’expérimentation dans de nombreux pays européens.
Par ailleurs, l’IA constitue un levier pour l’innovation dans des domaines tels que le stockage d’énergie et la gestion de la production photovoltaïque. Les efforts d’efficacité énergétique peuvent aider à maîtriser la demande croissante des centres de données, par le biais de technologies de refroidissement avancées et d’une territorialisation de la production énergétique.
Ressources critiques et enjeux géopolitiques
Un point commun entre l’IA et le Bitcoin est leur dépendance envers des ressources minérales spécifiques, comme le gallium, le cobalt et le lithium. La concentration géographique de ces ressources, principalement en Chine, pose des défis géopolitiques importants. Sécuriser les chaînes d’approvisionnement devient essentiel pour les deux secteurs.
Pour faire face à cette situation, un effort d’investissement et de planification est nécessaire de la part des gouvernements et des industriels. En parallèle, l’Europe explore la structuration d’une filière de semi-conducteurs plus autonome, afin de réduire sa vulnérabilité aux tensions internationales.